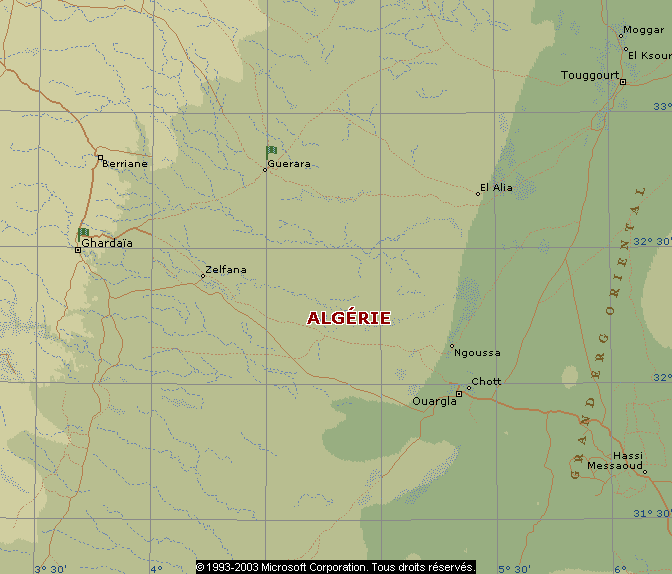
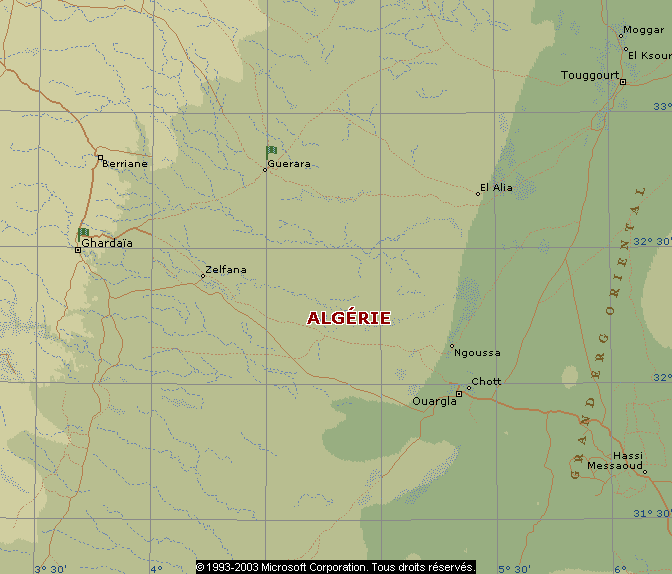
http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=30281
Actualité (Edition du 25/10/2004)
Après
Ghardaïa, Guerara
Les
émeutes se propagent dans le M’zab
Par Samia Lokmane Lu (1631 fois)
Des affrontements ont opposé samedi dernier, pour la seconde nuit consécutive, de jeunes manifestants aux forces anti-émeutes dépêchées de Ghardaïa, Laghouat et Hassi R’mel.
Bien que les raisons des troubles soient différentes, l’effet de contagion y est pour beaucoup dans le déclenchement d’émeutes à Guerara. Depuis vendredi soir, cette commune, située à 110 kilomètres du chef-lieu de la wilaya, a pris le relais de sa voisine Ghardaïa en devenant le théâtre d’échauffourées sporadiques entre de jeunes manifestants et les forces de l’ordre. Samedi soir, pour la seconde nuit consécutive, des affrontements violents ont entraîné l’interpellation de sept personnes. “Les notables de la ville ont pu obtenir leur libération, d’autant que la majorité est mineure”, révèle M. Khiat, membre élu de l’assemblée communale. La veille, l’initiative des élites locales s’est avérée infructueuse, puisque tous les jeunes arrêtés (au nombre de sept également) ont été transférés à la prison de Ghardaïa. Ils sont allés grossir les rangs des trente détenus de Ghardaïa incarcérés au motif d’avoir pris part à l’attroupement des commerçants locaux et participé au saccage des infrastructures publiques. Onze ont été condamnés mardi dernier à quatre mois de détention ferme. Onze autres, devant comparaître devant la juridiction pénale, encourent des peines plus lourdes. Si les habitants de la vallée du M’zab ont réagi à ce verdict en organisant un rassemblement devant le tribunal, les jeunes de Guerara sont allés plus loin. Vendredi dernier, dans la nuit, ils ont investi le siège de la cour, sorti les meubles et les ont brûlés sur la chaussée.
Sans doute ont-ils voulu prévenir par ce geste symbolique le traitement qui sera infligé à ceux d’entre eux qui seront pris dans les filets de la police. Un tel acte témoignait également de leur déconsidération pour la justice et ses différents appareils.
La preuve en est qu’un groupe parmi eux s’est adressé à la police pour lui demander réparation, sans que sa requête soit prise en compte. Et c’est cela qui déclenchera les émeutes. Toujours vendredi dans la soirée, des jeunes mozabites engagés pour assurer leur tour de garde dans le quartier Cheikh Mohamed El-Mouadin — la garde étant une pratique séculaire dans le M’zab — sont pris à parti par des individus appartenant à la communauté malékite. Selon M. Khiat, les provocateurs sont venus dans l’esprit de se venger suite à l’interpellation quelques jours plus tôt d’un des leurs pris en flagrant délit de vol. S’ensuit une rixe. Les sentinelles décident alors de prévenir la police. Mais les agents de l’ordre restent sourds à leur plainte. La tension monte. Et cette énième goutte fait déborder le vase. Déjà nourris de nombreux ressentiments, les jeunes mozabites cèdent à la violence. Une foule nombreuse investit la place centrale de la ville ou se trouvent le commissariat, la mairie et le palais de justice.
Armée de pierres, elle cible les différents édifices. L’éclairage public n’est pas épargné. Avant l’aube, des brigades antiémeutes, dépêchées de Ghardaïa, Laghouat et Hassi R’mel, arrivent à Guerara. Jusqu’à hier, le dispositif de sécurité n’était pas encore levé. Pour cause, bien que le wali se soit déplacé dans la commune, il n’est pas parvenu à désamorcer la situation. Outre les personnes interpellées, on dénombre de nombreux blessés parmi les manifestants. À ce jour, ni l’arbitrage du wali, ni les tentatives de règlement des notabilités n’ont pu porté leurs fruits. La tension est toujours vive d’autant qu’à l’instar de Ghardaïa, Guerara compte des détenus. Dans le sud du pays, ils tendent à devenir légion.
À Ouargla, aura lieu, aujourd’hui, le procés de dix représentants du mouvement des archs du sud dont son porte-parole Hafnaoui Ghoul ainsi que son jeune frère.
S. L.
http://www.elwatan.com/2004-10-25/2004-10-25-6694?var_recherche=emeute
Edition du 25 octobre 2004 > Actualite
Guerrara
(ghardaïa)
Cinq jeunes détenus
La ville de Guerrara, à quelque 110 km au nord-est de Ghardaïa, a retrouvé son calme habituel après les violentes manifestations de vendredi dernier. Selon le témoignage d’un habitant de la localité, c’est suite à une dispute qui a éclaté peu avant le f’tour entre deux Chaâmbas et deux Mozabites du même quartier que des émeutes se sont déclenchées.
Alors que les protagonistes étaient auditionnés par des policiers, une information sur des arrestations à venir a incité une population, chauffée à blanc après les événements de Ghardaïa, à manifester sa colère. Toujours selon notre interlocuteur contacté par téléphone, les rues de Guerrara ont été assaillies par quelque 3000 personnes qui jetaient des cailloux sur tous les édifices publics, dont certains n’ont pas échappé au feu. Et si aucun blessé n’est à déplorer suite à l’intervention musclée de la brigade antiémeute, sept personnes, dont deux mineurs, ont été arrêtées et présentées devant le parquet de Ghardaïa qui a libéré les mineurs et placé les cinq autres sous mandat de dépôt. Les chefs d’inculpation retenus sont attroupement illicite et incendie de biens d’autrui. Pour l’heure, un calme précaire règne sur les deux villes théâtre de ces graves heurts qui ont conduit à l’arrestation de 36 personnes à Ghardaïa, dont 11 ont écopé de 6 mois de prison ferme. Pour rappel, 11 autres détenus attendent la fin de l’instruction lancée la semaine dernière pour être jugés, tandis que 5 militants des droits de l’homme de la ville de Ghardaïa sont frappés d’un mandat d’arrêt prononcé au lendemain des émeutes survenues le 13 octobre dernier. Des informations concernant l’organisation imminente d’une marche pacifique de Bab El Haddad au siège de la wilaya circulent à Ghardaïa. Les commerçants demandent la libération des détenus sans poursuites judiciaires. Un appel relayé par un nouveau communiqué de la Ligue des droits de l’homme samedi dernier. La population dénonce la violence de l’intervention des services de l’ordre et la tournure prise par les événements. D’aucuns estiment que ces émeutes qui se généralisent dans la pentapole sont un cri de détresse contre l’injustice et la mauvaise gestion des affaires publiques dans la capitale du M’zab. Les commanditaires des trois émeutes successives survenues durant les derniers mois montrent du doigt les responsables locaux. Le wali de Ghardaïa est particulièrement visé.
Alioua Houria
http://www.elwatan.com/2004-10-26/2004-10-26-6769?var_recherche=emeute
Edition du 26 octobre 2004 > Actualite
Émeutes
à guerrara
« La libération des
détenus amènera le calme »
Lors d’un point de presse animé hier au siège de l’APN par le député d’El Islah, Boubekeur Salah est revenu longuement sur les événements qui ont secoué la wilaya de Ghardaïa, notamment la région de Guerrara. Le député a expliqué que les raisons qui ont poussé la population à se révolter ne sont pas similaires dans les deux villes.
Il a en premier lieu dénoncé le comportement négatif des agents des services de la police qui ont fait preuve d’excès de zèle, de bavures et autres dépassements. A Guerrara, ville de 55 000 habitants et située à 110 km au nord-est de Ghardaïa, le problème a commencé, de son avis, lorsque la population a décidé d’assurer sa propre protection contre les multiples vols qui se déroulent dans la localité en plein jour, et ce, en l’absence des agents des services de sécurité. Dans la nuit de jeudi, des jeunes ont décidé alors de monter la garde à tour de rôle à l’entrée du quartier Hadj Mohamed El Mouadine. Ce groupe, qui s’apprêtait à rompre le jeûne, a été agressé par un autre groupe composé de cinq individus venus d’une autre localité. « Personne n’a compris les véritables raisons de leur acharnement et agressivité. Il y a eu trois personnes blessées. Les victimes ont sollicité l’intervention des services de la police pour arrêter les agresseurs qui ont été identifiés. La police a malheureusement refusé d’agir et a demandé aux plaignants de déposer juste une plainte », dira le député. Le lendemain, la population est sortie dans la rue pour exprimer sa colère et sa solidarité avec les blessés. Les jeunes révoltés sont passés à l’acte en s’attaquant à tous les édifices de l’Etat, notamment les sièges de la police, de la daïra et de la justice. Pour cette dernière institution, les manifestants ont brûlé tous les dossiers et saccagé d’une manière indescriptible le local qui est une annexe du tribunal. « Les citoyens ont ciblé plus précisément le tribunal afin de manifester leur mécontentement contre les décisions, jugées injustes, prises dernièrement par le tribunal. Il y a quelques jours, un pauvre fellah a été frappé mortellement par un jeune. Celui-ci a été arrêté et libéré plus tard par voie de justice », dira le conférencier, qui estime que cette décision a été mal interprétée par la population. C’est ce qui explique la destruction du tribunal. Suite à la révolte des jeunes, les services de sécurité ont procédé à l’arrestation des cinq individus qui ont déclenché le premier incident. Par la suite, quatorze manifestants ont été arrêtés, dont sept libérés et les autres toujours en prison. « Lorsque les émeutes se sont déclenchées, nous nous sommes déplacés sur les lieux et nous avons joué le rôle de médiateur entre les différentes parties. » A la question de savoir s’il n’y a pas eu de manipulation politicienne de la part des représentants de partis ? Le député répond par la négation et accuse par là même les responsables au niveau de la wilaya. « Les walis n’admettent pas le soulèvement de la population. Mais dès que la manifestation s’installe, ils accusent les élus de manipulateur et de vouloir envenimer la situation afin de récupérer le mouvement. Cela est faux, nous essayons juste de calmer les esprits et d’insister auprès des autorités pour le règlement des problèmes dont souffre le citoyen. » Aujourd’hui, selon le député, la situation s’est sensiblement calmée et l’ensemble de la population demande la libération des détenus. « Cela relève de l’aberration. Actuellement, les citoyens n’essayent pas d’exposer et de négocier une plateforme de revendications, mais interviennent pour l’allégement des peines des détenus ou leur libération... » , dira le député qui demande aux autorités d’intervenir pour la prise en charge sérieuse des problèmes exposés par la population et de comprendre la révolte des jeunes qui, en somme, est légitime. « Nous demandons la libération des détenus qui, inévitablement, apportera l’apaisement », a-t-il souligné.
Nabila Amir
http://www.elwatan.com/2004-11-01/2004-11-01-7170?var_recherche=emeute
Edition du 1er novembre 2004 > Actualite
Guerrara
sombre dans la colère
Des atavismes
ethniques à la répression policière
Guerrara. 117 km du chef-lieu de Ghardaïa, à plus de 450 km d’Alger. Coincée au milieu du désert, cette terre clémente, paisible et calme se cherche toujours. Elle n’a pas trouvé celui qui peut lui prêter une oreille attentive. Elle s’éteint telle une bougie sous le vent. Connus pour leur sérénité et leur pacifisme, les Mozabites de la région vivent depuis des années sous le diktat des autorités locales, en silence. Pour exprimer leur colère contenue, ils empruntent, cette fois-ci, le langage le plus « expressif », celui de la violence, devenu le jargon national de toutes les strates sociales en souffrance. La passivité de la police a fait réveiller quelques atavismes des Mozabites. Ainsi, des émeutes ont éclaté il y a une semaine, samedi 23 octobre. Pourquoi ? En amont, il y a l’agression d’un groupe de vigiles mozabites par les Ouled Naïl (une population arabophone).
En aval, cela n’est qu’un motif pour déverser leur colère contre les pratiques policières qu’ils subissent quotidiennement. Voyage au cœur de cette contrée vivant sous le joug policier. Au carrefour de la sortie nord-est de la ville de Ghardaïa, une étendue de terres rocheuses se prolonge à perte de vue. Rien n’indique qu’une autre ville ou plutôt une vie peut exister ailleurs, n’était cette plaque de signalisation gigantesque qui s’impose : Guerrara 113 km, Ouargla 234 km et Laghouat 281 km. La route est longue. L’objectif est encore lointain. A peine l’horloge indique 8h qu’une chaleur torride s’abat sur nos corps, le mercure étant à 43°. La voiture roule à grande allure dévalant le chemin qui s’évanouit entre des monticules de calcaire dolomitique. Après avoir traversé Hassi Ouaraghnou et Berriane, nous rencontrons un semblant de vie pas loin d’une usine de batteries Tudor, près de 40 km de Ghardaïa. Un peu plus loin, Oued Laroui résiste humblement devant la cruauté de la nature, préservant l’âme aux quelques palmiers restant du patrimoine ancestral. Oued Laroui essaie de redonner vie à des végétations jaunâtres avec le concours du PNDA, qui se manifeste par les quelques forages réalisés. Ensuite viennent Oued Nissa, Oued Megrouna et Oued Griri, tous taris, à 13 km de la ville de Guerrara. Tout au long de la route les longeant, le « père » du PNDA a mis des signes visibles en guise de preuve que son plan est passé par ces terres jaunes dépourvues de toute végétation. A 3 km de l’entrée sud-ouest de la ville, un immense dépotoir qui n’a rien à envier à celui de Oued Smar (Alger) agresse les yeux. Le terrain est devenu « noir » de sachets noirs. C’est ici que les autorités locales déversent les ordures de plus de 100 000 habitants. Une odeur âcre commence à nous atteindre.
Révolte
A peine une pente de 90° est franchie en trombe que la ville de Guerrara lève son voile pour fasciner ses visiteurs. Engouffrée dans une cuvette oxygénée par la végétation luxuriante des oasis de Karazila, de Mangâa et de Bahdi, Guerrara se tient tant bien que mal debout, rejetant la fatalité. Il est 11h. La ville est morne, triste. Encore sous le choc. Au siège de la commune, bordant la place du 1er Novembre devenue le théâtre des échauffourées la semaine dernière, il n’y a presque personne. Sur le trottoir donnant sur le portail principal de l’administration, il ne reste que les restes de pneumatiques incendiés par les émeutiers. Au tribunal, une équipe des travaux publics s’échine à colmater les brèches et à combler les trous par une raclée de ciment blanc. Une autre équipe tente par un coup de rouleau pressé de laque de cacher les signes de la colère juvénile laissés par le feu ayant dévoré cet édifice. La succursale d’Algérie Poste a échappé de justesse à un saccage certain. Seule la plaque lumineuse est endommagée. Mais comment cela s’est-il produit ? Salah Eddine, un Mozabite, revient sur les faits. « Ici, nous montons la garde la nuit pour barrer le chemin aux voleurs. Ainsi, dans la nuit du vendredi 22 octobre, un groupe de vigiles, composé de cinq Mozabites, a fait une inspection du côté de la cité El Mouadhine, du village de Sidi Mohammed. C’était une tournée qu’on faisait régulièrement. Mais ce jour-là, je ne sais pas quelle mouche a piqué les résidents pour qu’ils agressent ce groupe de vigiles au point que l’un d’eux a été hospitalisé. Devant une telle brutalité, nous nous sommes déplacés au poste de police pour dénoncer les agresseurs qui étaient près d’une vingtaine. Mais la police n’a pas répondu à notre appel. Le lendemain, tous les Mozabites se sont rassemblés devant le commissariat pour s’insurger contre cette passivité de la police qui est censée nous protéger. Quelques jeunes n’ayant pu contenir leur colère ont jeté des pierres à l’intérieur de l’enceinte de la police. Les CNS ont répliqué illico presto par des bombes lacrymogènes. Et les émeutes ont éclaté pour ne cesser que l’après-midi, grâce à l’intervention des notables », relate-t-il. Les personnes qui ont agressé les vigiles mozabites sont originaires d’Ouled Naïl. « Ce sont des arrivistes. Ils ont leur quartier. Ils vivent à leur manière. Ils ont des traditions qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi agressent-ils nos hommes qui, pourtant, veillent sur la sécurité de leur maison et de leurs biens ? », atteste El Hadj Ahmed, un sage de la région. « Il s’agit d’abord d’une question de dignité. Ensuite, nous déplorons le fait que la police ne fait pas son travail qui, à la tombée de la nuit, se met en hibernation, ne quittant jamais l’enceinte du commissariat », ajoute-t-il colérique, le doigt pointé vers l’édifice de la police. Du côté de la cité El Mouadhine, tout est calme. Les habitants ont une autre version des faits. Pour eux, les vigiles ont franchi la « zone rouge », celle interdite aux Mozabites. « Nous considérons cela comme une atteinte à notre dignité. Ce que nous avons fait relève de la légitime défense », nous précise Mohamed Abdelwahab, un habitant. Ainsi, la lutte interethnique a cessé durant des années dans cette contrée étouffée par le climat et par le choix de la politique locale. Aujourd’hui, le diktat policier qui s’abat sur la localité réveille les vieux démons.
Un conflit ancien
Le conflit entre les Mozabites et les arabophones n’est pas nouveau. Il remonte à des siècles en arrière, avant même la création de la ville de Guerrara. Il y a 400 ans existaient deux tribus, l’une constituée de Mozabites, l’autre de Châamba. Ils étaient en guerre permanente. La région est ainsi divisée en deux ksour : « Ksar Lahaner et Aghram Baday. Ce n’est qu’après la venue du cheikh Barladja Ahmed que la paix s’y est installée pour que la région porte ensuite l’appellation de Guerrara », dit Khaled Oudjana, président de l’association Afouadj el jabiria. Les atavismes sont restés pour toujours. Il a suffi d’un geste maladroit des autorités locales pour les réveiller. Les escarmouches se sont soldées par l’arrestation de sept émeutiers, dont deux mineurs qui ont été relâchés. Les autres seront jugés juste après le 1er novembre. Quant aux agresseurs, la police procède à l’arrestation de quatre qui écoperont plus tard, soit le 26 octobre, de 2 mois de prison ferme. Après le verdict, la ville sombre une nouvelle fois dans la colère. Les Mozabites, mécontents des peines retenues contre ces derniers et affolés par le maintien en prison de leurs « frères », sont sur le qui-vive. « Il risque d’y avoir d’autres escarmouches dans un avenir proche, car la colère monte, surtout qu’une rumeur circule que les prisonniers (agresseurs) sont concernés par la grâce présidentielle, alors que les émeutiers détenus seront jugés en novembre », nous explique Khaled O.
Délabrement
EN sus de la hogra et de la loi de la matraque, la population mozabite « patauge » dans des problèmes nés de la gestion des autorités locales. La ville est dans un état lamentable. Les routes sont déformées par les incessants travaux, les trottoirs défoncés et le bâti délabré. Face à la place du 1er Novembre, des façades crasseuses donnent sur la rue, défigurant le tissu architectural qui met en évidence le savoir-faire et le génie mozabites des siècles passés. Les venelles menant au ksar datant du XVIIe siècle sont impraticables. A l’intérieur, les murs rongés par le poids des ans peinent pour ne pas s’effondrer. « Lorsqu’ils ont fait les canalisations de gaz, ils ont laissé les trous béants », nous fait savoir Abdelkrim, un citoyen rencontré sur les lieux. Cela a suscité l’ire de la population qui a avisé à maintes reprises les autorités locales, en vain. En dehors des luttes ethniques et de la hogra policière, Guerrara est la plus importante et grande zone économique de la wilaya de Ghardaïa. Disposant d’une superficie agricole de 16 440 ha, elle est considérée comme le pôle agricole de Ghardaïa. Elle figure parmi les communes les plus pressenties pour connaître une grande expansion touristique. Mais jusque-là, c’est seulement sur papier. La palmeraie qui occupe le plus grand chapitre du secteur agricole meurt à petit feu. Les oasis Mangaâ, Bahdi et Innourar sont complètement délaissées à cause d’un conflit qui perdure depuis la fin de la révolution agraire. Exploitées par les Châambas durant cette époque-là, elles sont maintenant l’objet d’un litige entre les Mozabites et les Ouled Naïl. Les éleveurs de bovins et d’ovins travaillent contre vents et marées. Confrontés à des problèmes multiples, ils résistent. Leur premier problème est l’indisponibilité de vaccins pour prémunir leurs cheptels de certaines maladies mortelles. Slimane Boubekeur est gestionnaire d’une petite unité de production de lait. Il est également éleveur de vaches. Aujourd’hui, il a peur de voir son cheptel atteint de maladies. Il s’inquiète aussi pour les autres éleveurs, car son activité dépend d’eux. « Les éleveurs font beaucoup d’efforts pour maintenir la production. Mais je remarque que les cheptels diminuent de plus en plus. Il faut plus de moyens et beaucoup d’encouragement pour cette activité », prévient-il. Slimane Boubekeur n’est pas seul. Il y a deux autres usines de production de lait et de yaourt : Khobzi et Slimani. Devant ce magma de problèmes et de conflits, la population locale ne voit que des mirages qui prolifèrent à l’horizon.
Mokrane Ait Ouarabi