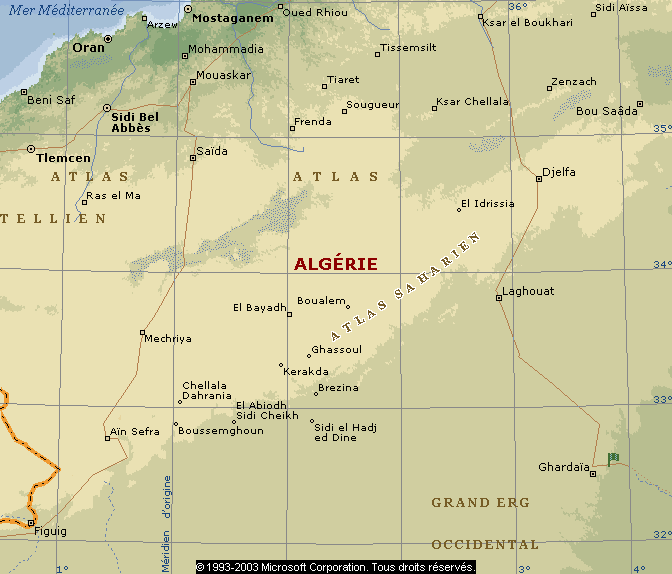
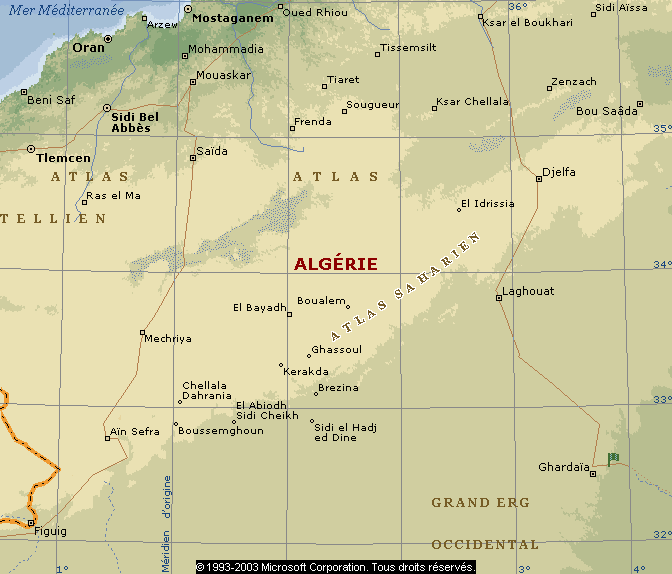
http://www.elwatan.com/2004-10-10/2004-10-10-5740?var_recherche=emeute
Edition du 10 octobre 2004 > Actualite
Annaba
Inexplicable
fermeture des commerces
Hier samedi dès 10h à Annaba, tous les commerces avaient inexplicablement baissé rideau. Alimentation générale, boucherie, pâtisserie, boulangerie, électroménager, salon de coiffure, pas un seul magasin n’était ouvert. Même les restaurants, cafés, fast-foods avaient suivi le mouvement d’une ambiance qui ressemblait fort à celle précédant des émeutes ou de grandes manifestations similaires à celles du 5 Octobre 1988.
Cette impression était consolidée par le survol incessant de l’espace aérien de la commune chef-lieu de wilaya par un hélicoptère militaire. Cette situation a créé un changement perceptible dans le comportement des habitants. Affolé, chacun se demandait ce qui pouvait bien se passer. Bon nombre de mères de famille demandaient à leurs enfants de rentrer alors que d’autres interdisaient aux leurs de sortir, même pour rejoindre l’école. La même ambiance s’est, par la suite, généralisée pour atteindre tout le territoire de la wilaya. Elle persistait encore durant l’après-midi avec des portes hermétiquement fermées des magasins, grandes surfaces et établissements implantés dans les rues et ruelles commerçantes du centre urbain, dans les cités et quartiers. Du côté des services de sûreté, comme de celui des représentants de différentes institutions de l’Etat, l’on n’est pas arrivé à expliquer cette situation. Interrogés, plusieurs commerçants ayant fermé boutique ont affirmé que leur mouvement fait suite à une information relative à l’arrivée d’une importante brigade de contrôle en provenance d’Alger. Cette brigade aurait pour mission de saisir tous les commerçants dans l’impossibilité de présenter les factures inhérentes aux produits mis en vente dans leur magasin. Une information que le directeur de la concurrence et des prix de la wilaya de Annaba, contacté, n’a pu confirmer ou infirmer. Cependant, au regard du nombre de commerces restés ouverts, à peine une dizaine pour l’ensemble du périmètre du centre urbain, force est de dire que la majorité des commerçants de Annaba pratique sans factures.
Djabali A
http://www.algeria-watch.de/fr/article/pol/revolte/ghardaia_greves.htm
Grève des commerçants: Cinquième jour
30 personnes en prison et 100 blessées à Ghardaia
Par :
A.Mourad, El Khabar, 16 octobre 2004
Des affrontements ont été enregistrés entre civils et forces de l'ordre
avant hier, jeudi, dans la ville de Ghardaia (sud du pays), 30 personnes sont en
détention préventive et prés de 100 personnes ont été blessées dans les
deux rangs.
Les commerçants de la ville sont en grève depuis cinq jours, le premier qui en
paie les frais est le citoyen surtout à la veille du mois de ramadan.
Selon une source proche des grévistes plus de 2800 commerçants observent la grève dans plusieurs communes de la ville de Ghardaia, ce qui est considéré comme la plus importante grève et la plus longue dans l'histoire de la ville.
Les protestations se sont poursuivies jeudi dernier, les affrontements entre force de l'ordre et civil ont fait, selon des sources hospitalières, entre 50 et 60 blessées civils et 36 agents des force de l'ordre.
Hier matin, le calme était de retour sur Ghardaia alors que l'on enregistrait quelques perturbations.
http://www.algeria-watch.de/fr/article/pol/revolte/ghardaia_greves.htm
La grève dure depuis quatre jours
Ghardaïa ville morte
Par A. HADJ DAOUD , Liberté, 16 octobre 2004
En ce début du mois de ramadhan, Ghardaia vit depuis quatre jours consécutifs, une opération “ville morte”, un mouvement qui est parfaitement suivi par la quasi-totalité des commerçants de la ville qui ont préféré garder leurs boutiques fermées pour protester contre la ruée des divers contrôles qui se sont abattus sur eux. Tardivement après la fermeture des commerces, une réunion, tenue au siège de la wilaya, a été provoquée par les autorités locales . Un face-à-face a mis aux prises les responsables des différents organes de contrôle à la commission représentative des commerçants de la ville, arbitré par le wali qui a voulu équilibrer la proportion contrôleurs-commerçants. Durant cette rencontre, chaque partie a cherché à défendre sa cause. M. Djamel Lekmèche, directeur du commerce de la wilaya de Ghardaïa, précise que le contrôle n’a aucun effet sur la fixation des prix. Ces derniers sont libres, donc soumis à la loi de l’offre et de la demande. Notre champ d’action, dit-il, se limite au contrôle de l’affichage des prix, à la facturation et à la lutte contre le commerce illicite, à défaut de registre du commerce. Il ajoute (contrairement aux réalités du terrain) que des brigades mixtes contrôleurs-agents des impôts effectuent des visites à travers tous les commerces de la wilaya. Ceci s’applique particulièrement sur les produits alimentaires de première nécessité qui sont vendus sans facture et à des prix exorbitants. Quant aux personnes représentatives des commerçants, elles ont mis l’accent sur la manière dont les contrôles ont été procédés par une brigade présidée par la douane, composée d’un douanier, d’un contrôleur des prix et d’un agent des services des impôts, (pourtant en grève). Ils ont, en outre, sollicité un allégement des procédures en matière de contrôle. Le wali avait, pour conclure, souligné que les contrôleurs ne sont que des auxiliaires de la justice et qu’ils ne peuvent agir en l’absence de textes réglementaires. Toute ingérence de la part des contrôleurs dans l’accomplissement de leur tâche serait en contradiction avec les textes. Devant cette conclusion, qui ne semble pas convaincre les commerçants qui menacent de faire durer la grève et l’entêtement des contrôleurs qui persistent sur l’application à la lettre des textes réglementaires au détriment des vrais “trabendistes” ambulants qui s’installent ou qui sillonnent la ville sans qu’ils soient pour le moins touchés ni inquiétés ? La contestation s’est alors étendue vers des jeunes chômeurs révoltés qui, à leur tour, ont voulu saisir l’occasion pour manifester leur mécontentement et leurs conditions de vie. Ce qui a d’ailleurs, provoqué des affrontements entre les services d’ordre et les manifestants déchaînés qui s’attaquèrent en premier aux édifices de l’État, (la poste, l’EPEG-Société des Eaux) au niveau de la placette d’Aïn-Lebeau et ont ensuite saccagé le monument qui embellit cette dernière. Il est à signaler des interpellations en masse ainsi qu’un bon nombre de blessés de part et d’autre, résultant des échanges de jets de pierres d’un côté et de bombes lacrymogènes de l’autre.
http://www.algeria-watch.de/fr/article/pol/revolte/situation_tendue_ghardaia.htm
Après les troubles de la semaine dernière, des manifestants aujourd’hui devant le juge
Situation tendue à Ghardaïa
Par Samia Lokmane, Liberté, 19 octobre 2004
Des mandats d’arrêt ont été lancés contre des membres de la Laddh et du
FFS alors que les 50 personnes interpellées mercredi dernier sont toujours en
détention. Le procès risque d’être houleux.
Une semaine après “la descente” d’une équipe de la Direction du
contrôle des prix et de la qualité chez les commerçants de Ghardaïa, la
situation reste toujours hérissée. Pis, les troubles qui ont secoué pendant
plusieurs jours la vallée du M’zab risquent d’être réédités en raison
de l’emballement de la machine judiciaire. En effet, alors qu’une
cinquantaine de personnes dont plusieurs commerçants, interpellées au cours d’une
manifestation mercredi dernier, sont toujours en détention, la répression
vient d’être élargie à des militants des droits de l’Homme et des
représentants d’un parti politique, en l’occurrence le Front des forces
socialistes (FFS).
Plus d’une dizaine de personnes, dont les six membres du bureau local de la
Ligue algérienne de la défense des droits de l’Homme (Laddh), quatre de ses
militants et les responsables de la fédération du FFS risquent, à leur tour,
d’être jetés en prison suite à l’émission, dimanche, de mandats d’arrêt
contre eux. “Au lieu d’explorer les voies de l’apaisement, les autorités
encouragent le pourrissement”, s’élève Kamaleddine Fekhar, vice-président
de l’antenne de la Laddh et élu du parti d’Aït Ahmed au sein de l’Assemblée
communale de Ghardaïa.
Outré, notre interlocuteur ne comprend pas qu’on puisse s’en prendre à
ceux-là mêmes qui ont entrepris de désamorcer la situation et de calmer les
esprits échauffés des manifestants. “Nous avons été auprès des jeunes
pour les exhorter à la sagesse. De même, nous avons tenté de nouer le
dialogue avec les autorités. Et c’est comme ça que nous sommes récompensés
!” tempête M. Fekhar. Selon lui, si la police franchit le pas et procède à
de nouvelles arrestations, un soulèvement sera inévitable. Il y a une semaine
pourtant, rien ne présageait une telle insurrection. Des mois après les
violents affrontements intercommunautaires entre Mozabites et Chaâmbas, tout
semblait rentrer dans l’ordre. Mais voilà que les ressentiments ethniques
reviennent à la surface. À l’origine, une tournée des brigades mixtes de la
Direction de la répression des fraudes dans les locaux commerciaux du
centre-ville. Cela s’est passé le lundi 11 octobre.
Qualifiant l’incursion des inspecteurs de discriminatoire, les boutiquiers d’origine
mozabite décident d’une action de protestation publique. Leur argument tient
au fait que des hordes de trabendistes essaiment les venelles de la cité et
sévissent sans crainte d’être appréhendés, alors qu’ils subissent, pour
leur part, le diktat des services du commerce.
Au lendemain de l’inspection, l’ensemble des marchands concernés observe
une grève et se rassemble sur la place de la révolution attenante au siège de
la wilaya. Un groupe muni d’une plateforme de revendications est dépêché au
siège de la wilaya pour solliciter une entrevue avec le wali. Rabrouée, la
délégation rejoint les contestataires bredouille. Le mépris, l’indifférence…
sont autant de motifs à l’escalade. La foule fulmine. Pour autant, le recours
à la violence est exclu. “Les commerçants ont manifesté jusqu’à la
tombée de la nuit de manière pacifique. Par la suite, chacun est rentré chez
lui dans le calme”, raconte M. Fekhar. Mercredi, la communauté des marchands
organise une marche puis un nouveau rassemblement. Néanmoins, cette fois-ci,
rien ne se passera plus dans le calme. Un important dispositif policier est mis
en place tôt le matin aux alentours de la place de la Révolution. Très
rapidement, des interpellations sont effectuées dans les rangs des
manifestants.
Outre les commerçants, des militants du FFS et de la Laddh sont appréhendés
par les éléments des forces de l’ordre. D’après le délégué de la Laddh,
la police a fait preuve d’une pure sauvagerie.
Le face-à-face a duré jusqu’à vendredi dans la nuit. Entre-temps, une
session de l’assemblée de wilaya est convoquée. Au cours de cette réunion,
le wali est pris à partie par les élus et le responsable du bureau de l’organisation
de Ali Yahia Abdenour. “C’est le wali qui pose problème”. “S’il avait
rencontré les commerçants et tendu l’oreille à leurs revendications, rien
de cela ne serait arrivé”, soutient M. Fekhar.
D’après lui, si les hostilités ont cessé, la tension est toujours de mise.
“Une peur indicible hante les gens”, confie-t-il encore. Les plus
éprouvées sont sans doute les familles des détenus. Aujourd’hui, une partie
d’entre eux sera présentée devant le juge. De l’issue du procès dépendra
la suite des événements.
Pour éviter “un règlement” à huis clos, la direction nationale de la
Laddh a tôt fait d’alerter l’opinion. Dans un communiqué transmis hier à
la rédaction, elle appelle à la solidarité nationale et internationale, et à
l’adresse également à l’Observatoire international pour la protection des
défenseurs des droits de l’Homme
http://www.elwatan.com/2004-10-20/2004-10-20-6413
Edition du 20 octobre 2004 > Actualite
Emeutes
de Ghardaïa
La justice a tranché
Le tribunal de Ghardaïa a rendu hier 26 jugements à l’encontre de 26 personnes interpellées mercredi dernier par les forces de sécurité suite au mouvement de protestation déclenché par des commerçants et des citoyens du centre-ville.
Les inculpés ont été auditionnés de 10 h à 14 h. Après une heure de délibération, les chefs d’accusation retenus contre eux : attroupement illicite et incitation à attroupement illicite. 11 personnes ont écopé de 4 mois de prison ferme, 7 de 8 mois de prison avec sursis et 7 autres ont bénéficié de la relaxe. Selon des témoignages concordants, des échauffourées ont éclaté à la sortie du tribunal. Des citoyens, nombreux à attendre le verdict, ont manifesté leur colère dans l’une des artères principales de la ville en dépit de la présence du service d’ordre. Les familles des inculpés, de simples citoyens, selon les déclarations faites devant la cour, ou travailleurs journaliers dans les commerces du vieux marché, jugent le verdict de la cour trop sévère et réclament une révision du jugement. Pour rappel, les événements de Ghardaïa ont été déclenchés trois jours avant le début de Ramadhan suite à une campagne de contrôle de la qualité et des prix jugée abusive. Les commerçants du vieux marché trouvent que les impôts sont trop lourds, d’où l’émeute. La grève entamée depuis mercredi dernier n’a pas été suivie dans tous les quartiers. Seuls les quincailleries et commerces de tissus et d’habillement observent toujours cette grève, selon les derniers échos reçus.
Alioua Houria
http://www.algeria-watch.de/fr/article/pol/revolte/revolte_ghardaia.htm
Algérie : vent de révolte à Ghardaïa
La condamnation de manifestants relance la colère
Par José Garçon, Libération, 21 octobre 2004
Tout indiquait des procès iniques et les avocats voulaient en demander le
report. Mais les familles y ont renoncé, une rumeur sciemment propagée
prévoyant un acquittement général... Le verdict - 7 relaxes sur 25 prévenus,
11 condamnations à quatre mois de prison ferme et 7 à huit mois avec sursis -
les a fait déchanter. Et a relancé, mardi, la révolte qui secoue depuis plus
d'une semaine la ville algérienne de Ghardaïa dans le Mzab. Nombreux autour du
tribunal, des groupes de jeunes ont lancé des pierres contre le service d'ordre
et attaqué façades du centre-ville et poteaux électriques...
Exaspération. Tout a commencé le 11 octobre avec la descente des brigades de
l'inspection des impôts, de la gendarmerie et du contrôle des prix et de la
qualité dans les magasins du centre-ville. L'intervention, aussi soudaine que
tatillonne, a exaspéré d'autant plus les boutiquiers d'origine mozabite que
d'innombrables trabendistes (trafiquants) agissent ouvertement sans jamais être
inquiétés. Décrétant une grève générale, les commerçants se rassemblent
alors près du siège de la willaya (préfecture) et demandent à rencontrer le
wali. Refus méprisant. Le rassemblement se poursuit dans le calme jusqu'à la
tombée de la nuit et reprend le lendemain. «Mais là les forces de l'ordre se
déchaînent, brûlent les mobylettes des commerçants, cassent les vitres des
voitures, frappent les gens et arrêtent une cinquantaine de personnes,
commerçants, militants de
Comment expliquer cette attitude des autorités des mois après les
affrontements intercommunautaires ayant opposé Mozabites et Chaâmbas et dans
une ville où les tensions ne manquent pas ? L'utilisation d'un terrain communal
a ainsi créé des frictions entre groupes de jeunes. Mais, surtout, une forte
tension régnait à Ghardaïa depuis les inondations d'avril, les habitants
ayant demandé - en vain - que la ville soit déclarée zone sinistrée. Alors
que les aides gouvernementales arrivaient très lentement, des camions d'aides
privées, venus notamment de Bejaia, étaient repoussés par le wali.
Ilot autonome. «Aujourd'hui, on se demande si on n'encourage pas le
pourrissement et si on ne veut pas relancer les tensions intercommunautaires,
dans la mesure où tous les détenus sont des Mozabites alors que tous les
commerçants grévistes ne l'étaient pas», remarque un homme d'affaires local.
Comme si les autorités, qui ont réussi à éteindre presque toute vie
politique, voulaient mettre au pas une communauté qui dérange car elle
constitue un îlot autonome d'organisation. Et casser un mouvement associatif
fort dans le Mzab. Dix autres inculpés devraient encore être jugés.
http://www.elwatan.com/2004-10-28/2004-10-28-6897?var_recherche=emeute
Edition du 28 octobre 2004 > Reportage
Après
les Émeutes de Ghardaïa
« Ils veulent nous
briser »
L’orage de colère est passé. Ghardaïa retient son souffle, deux semaines après les affrontements ayant eu lieu mercredi 13 octobre entre la population et les forces de l’ordre. Les commerçants, près de 2800, ont rouvert leurs magasins depuis samedi dernier.
Après les douloureux événements endurés, la ville pittoresque mozabite retrouve un calme précaire. La population, traumatisée, a du mal à s’en remettre. Mais la vie, interrompue le temps d’une protestation qui s’est soldée par une cinquantaine d’arrestations, essaie de reprendre petit à petit ses droits dans la capitale du M’zab, sous l’œil vigilant des CNS. Les principaux boulevards sont timidement animés en cette matinée de mardi. Peu de monde y circule. Sur l’artère jouxtant la wilaya, des jeunes avachis sont adossés aux murs. A. B. est terrorisé. Il n’a pas réalisé ce qui lui est arrivé un certain mercredi du mois en cours. Cette date reste une tache noire indélébile dans sa mémoire. « J’étais flegmatique, au milieu des manifestants rassemblés à la place de la Révolution. Je voulais juste me pointer en guise de solidarité avec nos commerçants. Subitement, un déluge de bombes lacrymogènes tombe sur nos têtes. Et c’est la panique générale. Alors, je me suis retiré de la foule pour emprunter une venelle, et voilà je me retrouve à la merci des policiers. Ceux-ci ne se contentent pas de m’insulter et de me bousculer, mais ils nous dénudent, moi et un autre jeune, de nos habits avant qu’ils nous relâchent nus », raconte-t-il, effrayé. Après les flétrissures qu’on lui a fait subir, A. B. n’ose même pas prononcer son nom de peur d’être entendu par un policier en civil. Guettant l’espoir sur le trottoir, il semble moralement complètement effondré. « Ils veulent nous briser, nous bâillonner et détruire notre civilisation ancestrale, héritée des temps les plus reculés », souffle-t-il, avant de se réfugier, une nouvelle fois, dans son silence, tout effarouché. Au centre-ville, tout semble être dans l’ordre établi. Rien ne peut indiquer qu’une vague de violence est passée par là, n’étaient les trottoirs désertés. « La ville n’était pas ainsi avant les événements. A cette heure-ci, 11h, les avenues sont débordées de monde. Les Mozabites sont des pacifistes et détestent la violence », nous fait remarquer un commerçant. Bab Salem Ouïssa, artère longeant la vallée du M’Zab, qui coupe la ville en deux, était le champ de bataille. C’est ici qu’il y a eu les plus graves affrontements. « Il y a eu quelques manifestants blessés. Fort heureusement, ce sont des égratignures superficielles. Rien de grave », annonce Brahim, un infirmier mozabite qui était parmi les marcheurs. Au bas du mur bordant la vallée, des projectiles, des pierres et des restes de pneus brûlés sont toujours là, annonciateurs des scènes de violence qui ont secoué la contrée. Des tubes de bombes lacrymogènes nous aveuglent par le reflet du soleil. Quelques écorchures et impacts sont encore visibles sur les façades des maisons plongeant sur la rue. De l’autre côté de la rivière, on peut lire un écriteau en caractères arabes badigeonnés sur le mur d’une association des scouts en construction : « Il faut que la grève des commerçants continue. Y en a marre de la hogra. Nous exigeons la libération immédiate des détenus et le départ du wali. » Un peu plus loin sur le pont Addaoua, il est écrit également en grosses lettres : « Où sont les promesses du wali ? » Retour sur les faits. Tout a commencé le 11 octobre lorsque des agents de la brigade mixte (services des prix et des impôts) sont venus contrôler les commerces. A peine trois magasins sont inspectés que les autres baissent rideau, l’un après l’autre. Vers 13h, aucun magasin n’est ouvert dans la ville. C’est le début d’une grève que viennent de décréter les commerçants. Réunis en urgence, ils décident de poursuivre le mouvement de protestation. Ils élaborent ainsi une plate-forme de revendications, dans laquelle ils soulèvent le problème du marché informel qui gagne du terrain dans la ville et qui crée une concurrence déloyale. Autre problème mis en exergue, c’est l’absence de facturation pour certains produits d’importation. « Je m’approvisionne d’Alger. Les vendeurs de gros ne me donnent jamais de factures. Quand je les leur demande, ils me rétorquent : “Ne t’inquiète pas, tu n’en auras pas besoin” Là-bas, à Alger ou dans d’autres lieux où atterrissent les marchandises importées, ce genre de commerçants exercent en toute liberté. Ici, chez-nous, en plein désert, l’Etat vient nous demander des facturations. Pourquoi il ne les exige pas d’abord aux importateurs de ces milliers de conteneurs qui achalandent le marché parallèle ? Est -ce cela la justice ? », fulmine Smaïl S., un grossiste. Cela n’est qu’une marge d’un tas de problèmes dans lesquels pataugent les Mozabites, dont le cri de détresse semble être étouffé par son éloignement du palais d’El Mouradia. Les commerçants se plaignent aussi du poids des charges, devenues insupportables. « Nous sommes logés à la même enseigne que les commerçants d’Alger. Les taxes qui nous sont imposées demeurent plus élevées que celles d’Alger, alors que le transport de la marchandise seulement nous revient dix fois plus cher que la capitale. C’est aberrant et excessif », conteste Djamel C., grossiste des articles de bureau.
Au milieu du désert
A l’intérieur de son magasin, il y a des produits locaux ainsi que ceux de l’importation. Ces derniers sont « moins chers et se vendent rapidement », reconnaît-il. Mais ils l’exposent à des procès et saisies des agents de contrôle. « Que faire ? Je ne suis pas le seul à les vendre. Au contraire, il n’y a que ça sur le marché. S’ils veulent vraiment réguler le marché, ils doivent commencer par là où ça fait mal, dans les ports et au niveau des frontières », tempête-t-il. Même son de cloche chez les autres commerçants. Ayant senti que la menace pèse sur leur gagne-pain, ils se révoltent. La goutte de trop. Mais la question des brigades mixtes n’est, à vrai dire, que la goutte qui a fait déborder le vase. Il y a eu un cumul de problèmes depuis les fameuses émeutes du 27 avril 2004 qui ont mis à feu la vallée. « Le commerce commence à être freiné chez nous en raison des contraintes multiples. Notre marge de bénéfice est très réduite, mais les impôts ne cessent de grimper. Nous devons défendre notre pain, sinon nous crèverons, sous l’œil indifférent de nos bureaucrates en chef », lâche-t-il encore, dubitatif. Ainsi, les marchands se demandent pourquoi on ne leur donne plus l’indemnité de zone. Abdelwahab R. a une papeterie à quelques pas du marché informel de Chouâbat Belhadj Daoud, où tout se vend et s’achète au vu et au su de tous. Hargneux, il vomira son aversion à notre rencontre : « Nos dirigeants sont irresponsables, non soucieux des souffrances de la population. Ils ont dû peut-être perdre leurs notions de géographie. Ghardaïa n’est ni Alger ni Oran. Elle est là, coincée au milieu du désert, où il n’y a aucune autre activité en dehors du commerce. Dans d’autres pays, des régions comme la nôtre sont classées zones spéciales et bénéficient d’un traitement et d’une politique qui tienne compte des spécificités de chacune. Chez nous, ils veulent qu’on paye tout et encore plus cher à chaque fois qu’on ouvre la bouche. » Vu les 33 points figurant sur la plate-forme de revendications, les commerçants du M’zab semblent fortement inspirés du mouvement revendicatif des agriculteurs de France, lesquels demandent depuis quelques jours la détaxation du carburant pour les professionnels du secteur, à la suite de l’augmentation des prix du pétrole. Abdelwahab évoque, en outre, certaines pratiques préférentielles et favoritistes de l’administration locale. « Les Mozabites sont depuis la création de la ville, de père en fils, dans le commerce, dont beaucoup font dans le gros. Mais lorsqu’il s’agit des gros marchés publics, les autorités locales les offrent à des gens loin de la région. C’est de la hogra », s’indigne-t-il. D’ailleurs, cette situation pousse aujourd’hui beaucoup de grossistes en difficulté à quitter la vallée à la conquête d’autres cieux plus cléments. « Nous gagnons peu, quand on ne perd pas », lance encore notre interlocuteur, plaintif. Devant ce blocus de problèmes inextricables, les commerçants s’insurgent surtout contre la hogra, devenue l’hymne des lobbies et des bureaucrates de la capitale du M’zab. Le wali n’est pas là. Onze octobre, le soir. Une délégation des commerçants grévistes se déplace à la wilaya dans l’espoir de rencontrer le wali, M. Boudiaf. Elle revient bredouille. Ainsi, les commerçants décident donc d’observer un sit-in le lendemain, 12 octobre, au centre-ville. Sit-in qui se déroule dans le calme. Les protestataires exigent la venue du wali, en personne, pour lui remettre en mains propres la plate-forme de revendications. Ce dernier ne viendra pas. Il envoie à sa place le P/APC, lequel, conspué par les manifestants complètement désemparés, revient bredouille. « J’ai reçu des coups qui m’ont laissé des ecchymoses sur le dos. Ils ne m’ont pas laissé le temps de parler », raconte le maire, Omar Fekhar. Le soir, il reçoit une délégation des commerçants venue lui expliquer que ce n’étaient pas eux qui l’avaient frappé, mais des intrus que personne ne connaît. Certains manifestants suspectent les services de sécurité. Provoqués et humiliés par l’indifférence du wali, les commerçants passent à une autre action. Mercredi 13 octobre. Un monde fou se regroupe sur la place de la Révolution, carrefour principal de la ville, répondant à l’appel à la marche des commerçants. Les CNS sont aussi au rendez-vous en renfort. Vu la situation, et par crainte d’un grave dérapage, les initiateurs ordonnent à la foule de s’asseoir à même le sol en psalmodiant des versets coraniques. Mais un geste suffit pour provoquer l’émeute. La manifestation qui s’est voulue pacifique se transformera en une fraction de seconde en affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants. Et voilà que la place devient une véritable arène de combat. Le bilan : des édifices publics réduits en cendres, quelques manifestants blessés, des motos brûlées, des voitures saccagées... La police s’en prend à tout le monde. Elle voit rouge et procède à des arrestations aléatoires, une sorte de razzia. Une pluie de bombes lacrymogènes tombe partout, même dans les patios et les balcons des maisons bordant la place. Brahim Reffis est l’une des victimes des arrestations des services de sécurité. Il est en prison, attendant son jugement pour un délit qu’il n’a jamais commis. « Il a été arrêté devant sa maison, aidant sa tante asphyxiée », témoigne un Mozabite présent sur les lieux. Ainsi, 50 personnes ont été arrêtées. 14 seront relâchées le même jour. Sur les 36 restant, 25 passeront devant la justice une semaine plus tard, soit le 19 octobre. La sentence prononcée fera état de onze condamnations à quatre mois fermes, sept à huit mois avec sursis et sept acquittements. Après le verdict, la colère monte d’un cran, surtout lorsque la population ne saura pas quand les onze détenus non encore jugés passeront devant la chambre criminelle. Les chefs d’inculpation retenus contre eux sont : incitation à l’insurrection, attroupement illicite, agression à arme blanche, saccage et détérioration des édifices publics et atteinte à l’ordre public. Mais à qui la faute ? A ceux qui ont initié cette marche ? Aux services de sécurité ayant exécuté les ordres de leurs chefs ? « Non, disent les Mozabites, c’est la faute au wali. » Il a refusé la médiation. Six mandats de dépôt sont sortis contre les membres de la ligue des droits de l’homme. Intervention des nobtales. Devant les graves dérapages et les nombreuses arrestations, les familles des notables de la ville, notamment les Boukrmouche et Kouzrit, s’immiscent pour rasséréner la population en ébullition. Mais l’absence du wali a envenimé la situation. L’après-midi du 13 octobre, une délégation, guidée par Mohamed Djermami, président du bureau de wilaya de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) et porte-parole de la fédération du FFS de Ghardaïa, obtient un accord de principe du wali de relâcher les détenus à condition que les escarmouches cessent. Les émeutes s’arrêtent quelque temps plus tard. Et les détenus croupissent toujours en prison. « Le wali a fait marche arrière et s’est éclipsé tout le week-end du 14-15 octobre. Il a peur d’affronter la population », précise M. Djermami, qui vit en clandestinité depuis une semaine, suite à la sortie d’un mandat de dépôt contre lui. « Le wali veut me faire porter le chapeau des émeutes, alors que je n’y étais pour rien. Au contraire, je voulais apporter ma contribution pour dénouer la situation », explique-t-il. Les commerçants ne demandent aujourd’hui que la libération en urgence de tous les détenus. Les notables saisissent par le biais d’un écrit le président de la République afin qu’il intervienne. Le président de LADDH s’échine, en catimini, avec des avocats à réunir toutes les preuves prouvant l’innocence des personnes arrêtées. Mohamed Djermami interpelle les autorités centrales et leur demande de dépêcher sur place une délégation pour solutionner les problèmes vitaux et endémiques dont souffre le M’zab. Sans cela, la vallée du M’zab risque de renouer avec la violence à tout moment, car les problèmes sont loin d’être réglés.
Mokrane Ait Ouarabi
http://www.elwatan.com/2004-11-03/2004-11-03-7263?var_recherche=emeute
Edition du 3 novembre 2004 > Idees-debat
Réconciliation, violence et déficit amoureux
Les incidents qu’a connus, ces derniers jours, la ville de Ghardaïa n’ont rien de singuliers, parce qu’ils auraient pu se produire dans n’importe quelle autre ville de notre vaste pays. Ces émeutes sont la conséquence inévitable de la situation déplorable que vivent nos jeunes dans nos villes de l’intérieur.
Ces explosions sociales, sous les formes les plus diverses, traduisent un problème sérieux qui exige une stratégie appropriée à l’échelle nationale. Dans le contexte algérien, il est assez facile d’aborder en termes intellectuels les questions qui se rapportent au domaine du public, à savoir le travail, l’habitat et les problèmes sociaux, même il n’est pas évident de toujours trouver des solutions pratiques aux problèmes posés. Mais quand le problème se pose en termes privés : le rapport au désir, à la violence, au sexe, c’est encore moins évident. Dans notre société, on ne parle jamais de la sexualité et des problèmes affectifs ni à titre individuel intime encore moins à la télévision. A l’intérieur de notre pays, on rencontre par rapport à cette question, une immense pudeur, notamment de la part des jeunes filles. Non seulement parce qu’on craint d’en parler, mais il n’y a pas de mots pour le dire. On n’a pas eu affaire à des gens qui parlent facilement de leur sexualité, c’est un sujet tabou. Alors, ils s’expriment autrement. Comment peut-on, ou pas, être amoureux en Algérie, quand on a vingt ans ? Les jeunes n’ arrivent pas à être amoureux aujourd’hui. S’ils y arrivent, c’est de manière relativement symbolique ; il y a un problème très sérieux autour des relations amoureuses en Algérie. Pourquoi cette difficulté à être amoureux ? Il y a bien sûr un climat général, social, qui fait qu’on a du mal à s’engager affectivement, à dire « je t’aime » à quelqu’un, mais aussi les jeunes ont un mal immense à se projeter dans une relation duelle. A avoir un rapport de l’un à l’autre, de soi au différent, à l’inverse, ces jeunes ont du mal à stabiliser leur comportement affectif. Cela n’a rien à voir avec la libéralisation des mœurs. Contrairement à ce qu’on pense, il n’y a pas de misère sexuelle, elle est juste restreinte. Par contre, je pense qu’il y a une immense misère affective, un certain dépit amoureux. Dans le temps, même, dans une société archaïque, non permissive et répressive, où l’espace des femmes était interdit aux hommes et vice-versa, il existait des relations amoureuses traditionnelles du monde rural. Aujourd’hui, ce monde défait son mode de fonctionnement. Par conséquent, les rapports amoureux également. On a donc de plus en plus de mal à stabiliser un rapport amoureux dans un rapport social, qui est lui-même défait. Premier constat et de première analyse, qui reste à confirmer, c’est l’existence d’un malheur amoureux en Algérie. Y a-t-il un lien entre la violence individuelle ou collective des jeunes et le déficit amoureux ? Effectivement, parmi les jeunes émeutiers, il y a certainement au-delà des principales préoccupations collectives qu’ils expriment des déficits amoureux dans leur vie personnelle, des carences affectives. Il y a une relation qui est, je dirai, même très forte, dominante entre un désert affectif et amoureux et la tentation de violence collective ; c’est très frappant, le désert affectif correspond à une logique de violence, de nihilisme, de désespoir collectif. On assiste à de très grandes violences dans notre société, on est dans une situation où les comportements individuels ne sont plus raisonnables, ni traduits en termes intellectuels, culturels ou collectifs. C’est chacun pour soi. Je ne veux pas brosser un tableau dramatique, je veux simplement dire que ces jeunes vivent des situations affectives qui ne sont pas très brillantes, qu’ils ont du mal à entrer dans des rapports amoureux plus classiques, avec un engagement individuel dans un rapport personnel avec quelqu’un d’autre. Je ne négligerai pas les énormes ravages que font auprès des jeunes le chômage et la galère. Ceux-ci n’ont aucune satisfaction concrète. Le système éducatif n’est pas stimulant. Les travaux offerts sont ternes et bureaucratisés. La vie culturelle est éteinte, la vie sexuelle restreinte. Les loisirs sont peu nombreux ou inexistants. Très peu de rêves et pas de produits pour les engendrer. Rêver pour un jeune est comme jouer pour un enfant. C’est thérapeutique. Le fait même de rêver est indispensable. Un jeune que l’on priverait de ses rêveries éveillées, risque la mort psychique. Peu importe, le contenu du rêve, et peu importe sa réalisation, l’essentiel est de rêver. Dans ce sens, j’ai l’impression qu’il y a, dans ce domaine, une totale déconnexion entre les discours officiels, encore très marqués par les partis politiques, les mosquées, ce qui est permis à dire, et ce qui ne l’est pas, les journaux, etc., et un autre discours celui des jeunes, qui au fond n’est peut-être pas un discours mais un non-dit. Le discours dominant, celui des institutions, des gens qui ont les moyens de s’exprimer, reste très prudent, alors que l’autre discours n’est jamais prononcé. Il y a un décalage réel entre le discours public et le vécu privé des jeunes, même par rapport à des politiques publiques, officielles, à tout ce qui est mis en place dans nos villes de l’intérieur. Il y a toujours un décalage entre ce qui est dit par les institutions et ce qui se pratique sur le terrain, et entre ce qui est fait et ressenti par les jeunes. Si nous voulons savoir ce qui se passe dans ces villes, nous découvrons que la manière dont les jeunes parlent de ce qu’ils vivent n’est jamais traduite d’une manière politique ou institutionnelle. A partir de là, on peut extrapoler en disant que s’il y a aujourd’hui entre autres, violence dans ces villes, ce n’est pas un hasard, c’est parce qu’il y a un décalage entre les discours et les pratiques politico-administratives et institutionnelles, d’une part, et d’autre part le vécu personnel et quotidien de ces jeunes, que la reconnaissance de ce qui est dit n’existe pas. Cela dit, nous observons seulement qu’il y a une distance énorme entre ce qui est dit et ressenti, et ce qui est traduit politiquement. Il est tout de même inquiétant ce décalage entre ce qui est exprimé par nos jeunes et le discours public officiel. Pour nous qui sommes des citoyens, et à ce titre, nous ne sommes pas tout à fait indifférents à ce qui se passe. Toutefois, les problèmes des jeunes, que j’ai cités plus haut, ne sont plus tout à fait des problèmes privés, puisqu’ils appartiennent au domaine du public, dès qu’il s’agit de violence. Comment introduire du public dans du privé et vice-versa ? C’est très difficile, surtout lorsqu’on a affaire à des jeunes qui ont du mal à exprimer autre chose que ce qu’ils ressentent sur le moment, le moment précis de l’urgence. Cela nous pose des questions centrales auxquelles les pouvoirs publics devraient trouver des réponses : comment rendre compte de la parole d’habitants, des citoyens, des gens qui vivent des situations dramatiques. Comment introduire leur parole dans les discours et dans les pratiques publiques ? Je sais que ce n’est pas non plus facile, parce que la frontière n’est jamais nette entre le domaine privé et le domaine public, mais il y a urgence à trouver des solutions. Réfléchir à une meilleure articulation de l’école, de la formation et de l’emploi des jeunes, il faudrait réfléchir comment manifester le souci de considérer les jeunes comme ils sont, de les accueillir en les reconnaissant dans leurs attitudes et leurs comportements spécifiques. Il faudrait des messages envers les jeunes, un peu plus positifs, personnels, affectifs, touchant un peu plus les gens dans ce qu’ils ressentent. Ne soyons surtout pas pessimistes, le meilleur est à venir, et l’Algérie de la réconciliation suppose une prise de conscience sociale de la part de chacun de nous, cela suppose aussi, une certaine ouverture sur les autres, sur ceux marqués par le sentiment de perte, de défaite, de destin raté, sur ceux qui subissent aussi la violence du silence imposé. Chaque Algérien a une mission au sein de la société pour lutter contre toute violence. A cet égard, je suis convaincu que par sa seule existence, la réconciliation aura prouvé quelque chose. Elle aura donné une leçon de méthode à tous ceux qui ont prôné le changement, elle aura illustré la voie d’une démarche véritable de bien vivre ensemble. Une démarche qui rompt avec le bavardage et qui bouscule les habitudes.
(* Sociologue).
http://www.liberte-algerie.com/edit.php?id=30871
Actualité (Edition du 9/11/2004)
Après les troubles de
Ghardaïa
Le Dr Fekhar retourne en
prison
Par Samia Lokmane Lu
(1787 fois)
Il
est accusé d’incitation à l’émeute, d’incendie volontaire, d’atteinte
à l’ordre public et d’agression à l’arme blanche.
Le
Dr Kameledinne Fekhar est retourné, hier, en prison au terme de son audition
dans la matinée par le juge d’instruction près la cour de Ghardaïa. Coiffé
de nombreuses casquettes, le prévenu est à la fois premier secrétaire
régional du Front des forces socialistes (FFS), représentant de
De prime abord, la pièce en question n’a rien à voir avec le dossier d’inculpation.
Or, cette exhumation tient dans la volonté de faire taire définitivement les
voix discordantes. À Ghardaïa pourtant, le retour au calme relève d’un pur
vœu pieux. Le sort incertain des onze détenus, toujours en attente de leur
procès, et la sentence lourde, infligée à onze autres, alimentent la tension
et nourrissent les rancunes de la population. La semaine prochaine auront lieu
les procès en première instance et en appel. De la nature des verdicts
dépendra la suite des évènements. La quiétude de toute une région en est
tributaire.
S.
L.